
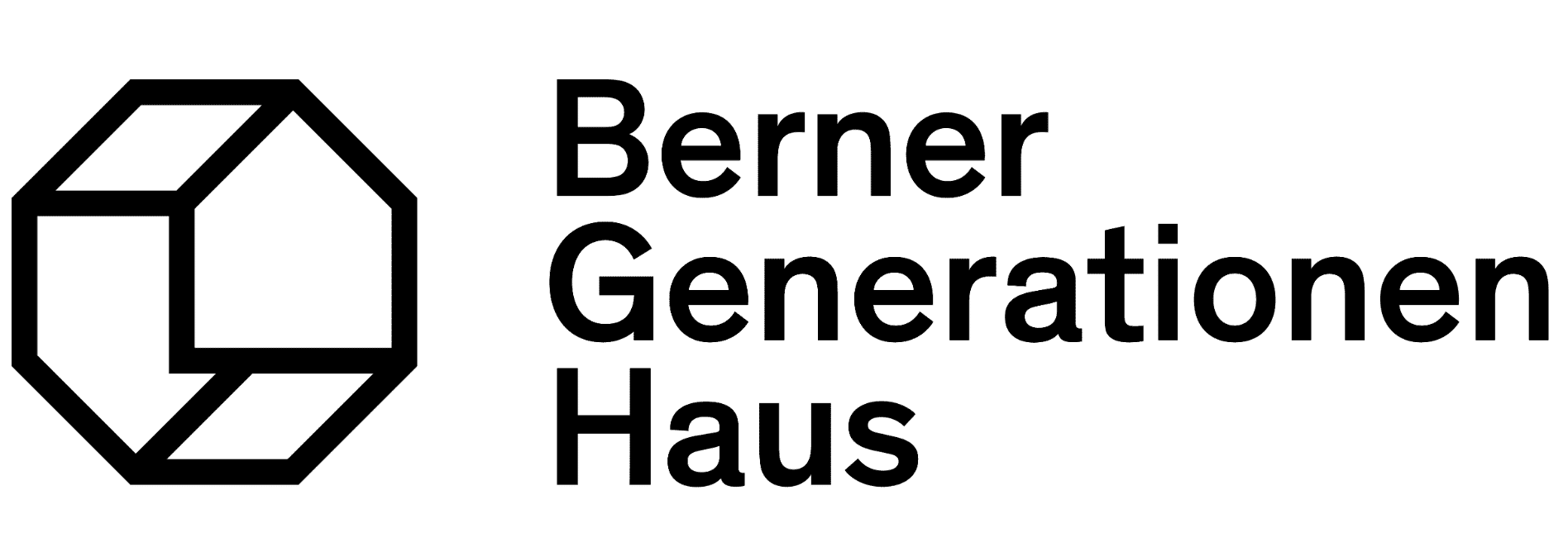
Du projet
Ceci est une traduction automatique.
Passer à la langue originale.
"La justice sociale fera l'objet de discussions plus nombreuses et plus pointues".
>La crise climatique, la question des retraites, le vieillissement démographique et actuellement la situation pandémique mettent à l'épreuve les relations entre les générations. Un conflit de générations est-il en train de se préparer ? Non, affirme l'anthropologue sociale et chercheuse sur les générations Simone Gretler Heusser. Mais il faut du courage pour lutter contre les inégalités sociales croissantes avec de nouvelles idées.
Interview : Andy Hochstrasser, Maison des générations de Berne | Image : ZVG
Des affrontements entre des jeunes et la police ont eu lieu récemment à Saint-Gall. Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes?
Les jeunes paient un prix énorme dans la coronapandémie. Une année de pandémie est sans doute plus décisive à 16 ans qu'à 70 ans. De nombreux jeunes qui sortent maintenant de l'école ont du mal à trouver une place d'apprentissage ou de stage. Ou alors, ils terminent un apprentissage et ne peuvent ensuite pas travailler dans leur profession. Pensez à tous les professionnels de la restauration qui ne peuvent pas travailler parce que les restaurants sont fermés ! De nombreux jeunes souffrent en outre d'une grande pression psychique et ne reçoivent pas toujours l'aide dont ils auraient besoin, car nous sommes sous-équipés dans le domaine de la psychiatrie des jeunes. Et pourtant, je trouve que la grande majorité des jeunes sont prévenants, bien informés et réservés. Je ne saurais trop insister sur le fait que la société devrait être reconnaissante envers les jeunes!
Et à long terme - quel est l'impact de la coronapandémie sur les jeunes?
.De nombreux jeunes regardaient déjà l'avenir avec angoisse avant la pandémie. Ils ont peur pour la planète et observent la mondialisation avec inquiétude. La pandémie renforce encore ces craintes. Nous devons prendre cela au sérieux. Les jeunes devront supporter une grande partie des conséquences financières de la pandémie. Et nous avons aussi un problème de retraite. Aujourd'hui déjà, les jeunes ont une mauvaise situation de départ en ce qui concerne leur prévoyance vieillesse, et cette situation devrait encore s'aggraver avec la coronapandémie.
L'enquête menée en septembre dernier pour le Baromètre des générations 2020 a révélé qu'aucun conflit de générations à proprement parler n'était perçu en Suisse. Les personnes interrogées voyaient plutôt le risque que la Suisse se divise entre riches et pauvres, entre ville et campagne ou entre droite et gauche. La pandémie de coronavirus a-t-elle depuis lors changé quelque chose à cela et alimenté un conflit entre les générations?
Je vois beaucoup d'espoir et peu de dangers. Certes, la pandémie de coronavirus met à l'épreuve les relations entre les générations, car toutes sont touchées différemment. Mais elle a aussi suscité une grande solidarité, notamment de la part des jeunes. Je ne pense donc pas que le conflit entre les générations s'aggravera - mais le débat sur la justice sociale, oui. Dans l'intérêt de tous, nous devons chercher des solutions pour financer les conséquences de la pandémie et la prévoyance vieillesse de la manière la plus équitable possible. En Suisse, mais aussi à l'échelle mondiale, les inégalités sociales se sont accrues avec la pandémie, et ce malgré des manifestations ponctuelles de solidarité comme l'initiative CoVax, dont l'objectif est d'approvisionner également les pays pauvres en vaccins.
On sait depuis longtemps que la prévoyance vieillesse est de plus en plus en difficulté financière. Mais jusqu'à présent, les jeunes préfèrent descendre dans la rue pour les protestations climatiques et non pour l'AVS. Pourquoi ?
.Ils perçoivent la prévoyance vieillesse comme moins menaçante. La pandémie leur montre justement que l'Etat social fonctionne dans une certaine mesure. Bien sûr, c'est terrible quand quelqu'un perd son emploi. Mais personne n'est complètement perdu. Nous sommes dans une situation très différente de celle des gens dans d'autres États, et cela vaut aussi pour la prévoyance vieillesse. Le changement climatique, en revanche, est une menace existentielle pour toute l'humanité, et les jeunes le ressentent intuitivement. Comparée au changement climatique, la prévoyance vieillesse est plutôt un problème de luxe à leurs yeux. Et cette perception est tout à fait rationnelle et réaliste.
Lors des manifestations pour le climat, on se moque souvent des jeunes. Les plus âgés devraient-ils les prendre plus au sérieux?
.Je pense effectivement que les préoccupations des jeunes ne sont pas suffisamment prises au sérieux - et pas seulement depuis la crise climatique ou la pandémie. Certes, les jeunes sont un peu mieux représentés dans les parlements actuels qu'auparavant, mais leur composition est encore loin d'être représentative de la population. Il suffit de regarder la participation aux élections pour s'en rendre compte : Les personnes âgées et bien formées participent beaucoup plus aux élections et aux votations, alors que les jeunes sont sous-représentés dans le système politique. C'est un paradoxe : en Suisse, nous sommes fiers de la démocratie directe. Mais en fait, tout le monde sait que seule une petite minorité a vraiment son mot à dire.
Faudrait-il donc abaisser l'âge du droit de vote de 18 à 16 ans ? La commission compétente du Conseil des Etats a approuvé ce projet en février, de manière quelque peu surprenante
.Pour moi aussi, cette décision a été une surprise. C'est un signal positif - peut-être que les changements démographiques sont effectivement un peu entrés dans les têtes des gens. Toutefois, l'abaissement de l'âge du droit de vote ne suffira pas. Si nous voulons vraiment que les jeunes votent davantage, nous devons leur apprendre à s'en servir dès leur plus jeune âge. Nous devons leur offrir des possibilités de participation réelle et stimuler des échanges avec d'autres générations, qui seront enrichissants pour tous. En Suisse, la participation politique des enfants a besoin d'être développée.
Vous voyez ici aussi la responsabilité des écoles?
.C'est un point important. Des études montrent que les enfants participent beaucoup en Suisse. Ils participent par exemple à l'achat de la voiture de leurs parents ou à la préparation des repas. Mais lorsqu'il s'agit de la participation politique, la Suisse est à la traîne par rapport aux autres pays. A l'école, elle ne joue pratiquement aucun rôle, surtout lorsque les enfants et les jeunes ne fréquentent pas d'école secondaire. Il serait pourtant important de les éduquer pour qu'ils deviennent des "citoyennes" et des "citoyens" au sens de la "citoyenneté" ou du "civisme", c'est-à-dire de leur montrer que chacun fait partie de la société et a son mot à dire. Pour cela, l'école est un lieu important. Pour les écoles, cela ne doit pas signifier encore plus d'efforts, il s'agit plutôt d'aiguiser la conscience et de développer une attitude.
Dans le baromètre des générations 2020, le soutien à l'abaissement de l'âge du droit de vote de 18 à 16 ans était faible, même chez les jeunes adultes. A quoi cela peut-il être dû ?
Peut-être que l'intérêt était encore trop faible. J'espère que la décision de la commission du Conseil des Etats changera cela. C'est une chance d'aller maintenant à la rencontre des jeunes, par exemple par le biais des associations de jeunesse ou de l'animation jeunesse en milieu ouvert, qui sont très bien organisées en Suisse. Elles pourraient offrir leur aide pour développer de nouveaux formats permettant aux jeunes de participer davantage. Abaisser simplement l'âge du droit de vote dans un acte souverain ne changera pas grand-chose - il faut travailler à la base.
Les partis jouent un rôle important dans le processus politique. Ils souffrent toutefois d'une image poussiéreuse. Selon Klaus Hurrelmann, chercheur allemand spécialiste de la jeunesse, les jeunes perçoivent souvent les partis comme des monstres bureaucratiques et ne s'engagent donc pas. Cela ne concerne pas seulement les jeunes. De manière générale, il y a de moins en moins de soldats des partis. Cependant, il y a beaucoup de gens intéressés par la politique. Ils préfèrent aujourd'hui s'engager pour un thème plutôt que pour un parti. Nous le voyons avec la jeunesse pour le climat - il s'agit d'une préoccupation concrète. Cela parle davantage aux jeunes qu'un programme de parti. Les partis doivent revoir leurs structures. Il faut certes de la continuité, car on ne peut pas résoudre chaque problème ad hoc. Mais en même temps, il doit y avoir plus de possibilités de faire entendre sa voix en fonction de la situation et des thèmes. On observe une tendance similaire dans la vie associative : les gens ne sont plus prêts à adhérer facilement à une association, mais s'engagent volontiers pour des causes ou des événements particuliers.
Dans le baromètre des générations 2020, une idée de réforme politique a rencontré une large approbation : à savoir le "service communautaire". Celui-ci mise sur une obligation générale de servir pour tous les jeunes hommes et femmes à partir de 18 ans. Outre le service militaire, il serait par exemple possible de prodiguer des soins aux personnes âgées. Je trouve séduisante l'idée que l'on fasse quelque chose pour la communauté au moins une fois dans sa vie. Cela fait du bien à tout le monde de s'engager de cette manière. Et cela pourrait être un point de départ pour d'autres engagements sociaux ou faire partie d'une éducation politique dont nous avons parlé plus tôt. Le service communautaire créerait des possibilités de rencontres et d'échanges. Cependant, beaucoup de choses devraient encore être clarifiées. Il serait important que le service communautaire ne soit pas utilisé abusivement pour économiser de l'argent - il ne devrait pas remplacer une main-d'œuvre qualifiée. Et la répartition des personnes dans des projets appropriés, le "matching", est importante et exigeante, on le sait dans le travail bénévole. L'idée d'une "durée de travail à vie", c'est-à-dire que chacun travaille globalement la même durée, mais que le moment de la vie où cela se produit ne joue aucun rôle, a également été très bien accueillie C'est absolument le modèle de l'avenir et c'est bien mieux que de simplement dire que tout le monde doit travailler plus longtemps pour sauver la prévoyance vieillesse. Un "temps de travail à vie" permettrait par exemple aux parents de prendre un congé de la vie professionnelle lorsque les enfants sont petits et de travailler plus longtemps. La mise en œuvre est toutefois complexe, car les formations, les taux d'occupation et d'autres facteurs varient. Mais il est clair que nous devons changer de mentalité. Travailler d'abord et recevoir une pension ensuite, cela ne fonctionne plus à long terme dans notre société vieillissante.
Mais il semble que le chemin vers le changement soit très long en Suisse. Notre système politique est inerte, et cela énerve par exemple les jeunes du climat. Je ne le trouve pas seulement mauvais. Une démocratie est plus lente qu'une dictature, mais les décisions sont plus durables. Ce que je regrette toutefois, c'est qu'en Suisse, la pensée innovante est généralement considérée comme une affaire privée. Quand quelque chose fonctionne bien, on l'adopte. Je souhaiterais que l'État s'engage davantage dans ce domaine.
L'État suisse devrait-il donc s'ouvrir encore plus aux nouvelles idées - et investir dans la société du futur, comme d'autres le font ? Le Pays de Galles, par exemple, a une commissaire pour les générations futures "S'ouvrir" est une belle expression. Il n'est pas nécessaire de créer un nouveau département, mais il serait temps d'être courageux et d'oser un projet et de voir ce qui en résulte. En Suisse, beaucoup de choses se passent "bottom-up", c'est-à-dire du bas vers le haut. Bien que "bas" ne soit pas tout à fait exact - souvent, les initiatives sociales en Suisse sont des manifestations de la classe moyenne. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut être conscient que tout le monde n'est pas atteint, loin de là. Les impulsions pourraient tout à fait venir du haut vers le bas, comme dans d'autres pays - cela ne toucherait peut-être pas plus de personnes, mais d'autres. La décision de la commission du Conseil des Etats sur l'âge du droit de vote pourrait en être un exemple : Cette décision "d'en haut" pourrait avoir un impact sur la base. Si l'État s'adresse désormais aussi aux jeunes qui ne sont pas déjà politisés, quelque chose pourrait se mettre en mouvement, ce qui serait bon pour notre démocratie. "Bottom-up" – ; le mot convient à la jeunesse climatique, qui en appelle au gouvernement et demande avec véhémence un changement rapide de mentalité. Or, de telles exigences ne sont pas seulement bien accueillies par les personnes âgées.
C'est certainement aussi une question de tonalité. Les gens communiquent différemment. Les activistes climatiques plus âgés, par exemple, recherchent peut-être plutôt une discussion au Parlement, tandis que les plus jeunes occupent la Place fédérale pour se faire entendre. Il est normal que le ton soit plus rude dans les mouvements de protestation qu'au Parlement et ce n'est pas la fin du monde. L'important est qu'un dialogue soit possible. Lorsque les activistes climatiques occupent la Place fédérale, ils peuvent aller à la rencontre des gens et expliquer leurs actions. Cela a un autre effet qu'une "occupation belliqueuse". La bienséance et le dialogue présupposent un intérêt mutuel, et cela n'est pas toujours garanti à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas un problème de génération, c'est un problème de société. Qu'en déduisez-vous concernant les affrontements de St-Gall? Il faut bien sûr prendre les incidents au sérieux et y réagir. Mais la répression seule ne peut pas être la réponse. Il est important que la société reconnaisse que la situation actuelle est un énorme fardeau pour les jeunes. Et que l'on essaie de rester en contact avec eux, par exemple par le biais de l'animation jeunesse. Je trouve par exemple que l'idée des jeunes partis d'inclure les voix des jeunes dans la taskforce Corona est une très bonne idée. Nous devons éviter une division entre jeunes et vieux. Se rejeter mutuellement la faute ne sert à rien - personne n'est responsable de cette pandémie. Et le fait que nous n'ayons pas le droit de nous serrer dans les bras nous concerne finalement tous. *Simone Gretler Heusser est chargée de cours et responsable du centre de compétences Générations et société à la Haute école de Lucerne – ; Travail social. Baromètre des générations 2020: Qu'est-ce qui motive les jeunes et les vieux ? Le baromètre des générations 2020 prend le pouls de la population suisse et veut stimuler un dialogue social sur les relations intergénérationnelles porteuses d'avenir. Pour ce faire, la Maison des générations de Berne a mené une étude représentative en collaboration avec l'institut de recherche SOTOMO ;. En septembre 2020, 3285 personnes au total ont été interrogées dans toute la Suisse. Les résultats ont été publiés début novembre 2020.
Ces projets pourraient également vous intéresser.
Ce projet vous plaît? Faites-le savoir avec un cœur.

Chant de Noël intergénérationnel à Zoug
Un événement de l'Avent plein d'ambiance pour petits et grands : le chant intergénérationnel de Noël.
Ce projet vous plaît? Faites-le savoir avec un cœur.

Chœur intergénérationnel de Berne
Une chorale qui a pour but de promouvoir le plaisir de la musique de manière intergénérationnelle et à bas seuil, et d'organiser des concerts.
Ce projet vous plaît? Faites-le savoir avec un cœur.

Vieux et jeunes se rencontrent à Hünibach
Grâce à la collaboration intergénérationnelle entre la crèche Eichgüetli et la maison de retraite Seegarten, jeunes et vieux se rencontrent à Hünibach (canton de Berne).


